La dictature des "petites assiettes à partager" est-elle (enfin) terminée ?
Après avoir surfé sur la tendance des "petites assiettes à partager" jusqu'à l'excès, les restaurants font machine-arrière face à la colère des clients. Mais désormais, comment surmonter cette crise de confiance et ce sentiment de trahison ?
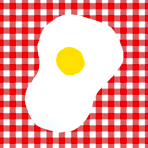
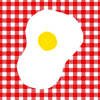
Il n’y a pas si longtemps, aller au restaurant était un plaisir simple.
On glissait les pieds sous la table, on commandait le plat qui nous faisait envie, et on réglait notre addition, simplement et logiquement.
Mais qu’il semble loin, aujourd‘hui, ce temps où l’on s’attablait, insouciants et le cœur léger. Ce temps où l’on balayait des yeux un menu avec excitation, sans appréhension, ni stress, ni angoisse. Ce temps où les cartes tenaient sur la moitié d’une page A4 et ne s’encombraient pas, encore, d’intitulés de plats énigmatiques, empilés et superposés dans un ordre aléatoire.
Entrée, plat, dessert. Et le tour était joué.
Sauf que, depuis quelques années, cet équilibre séculaire, codifié et protocolaire, charpente de la restauration contemporaine, s’est subtilement évaporé. Portés par un élan de liberté et une soif de renouveau, de nombreux restaurants ont fait le choix de chambouler la Sainte-Trinité de “l’entrée + plat + dessert”.
Au début, c’était marrant, nouveau, et rafraîchissant.
On découvrait de nouvelles choses, on mettait volontiers de côté notre libre-arbitre pour s’en remettre aux suggestions des serveurs. Des chefs et cheffes s’épanouissaient en envoyant balader les codes rigides et poussiéreux de la cuisine et construisaient (enfin) des cartes désenclavées, plurielles et émancipées.
Puis, le vent a tourné, laissant des menus à rallonge, chaotiques et difficilement lisibles, prendre le pouvoir. À tel point qu’une fois la commande passée, personne ne savait vraiment ce qu’il allait trouver dans son assiette.
Cette tendance, née au début des années 2010, inspirée des mezzés du Moyen-Orient, de l’izakaya japonais ou des tapas espagnols, a connu son heure de gloire… mais a fini par décevoir, frustrer et lasser. Pire encore, cette vague de “petites assiettes à partager” a viré au ras-le-bol et à un profond sentiment de trahison chez les clients.
D’une promesse de liberté et de convivialité, tout cela a fini par tourner au vinaigre. Ce qui devait nous offrir une célébration du partage et de la commensalité s’est vite transformé en traquenard. Parce que l’on a fini par réaliser que tout le monde n’aime pas forcément partager sa gamelle – ou, en tout cas, être contraint de le faire. Parce que l’on ne savait plus qui devait choisir les plats pour la tablée toute entière. Et parce qu’à la fin du repas, personne ne savait vraiment quoi payer. “On partage ? On divise ? T’as mangé plus que moi… Comment on fait ?”.
Assez vite, ce nouveau souffle, qui aurait dû nous épanouir et révolutionner l’expérience à table, a viré à la mascarade. Après des années de partage forcé, c’est désormais le besoin de clarté, de limites, et peut-être même d’une intimité du coup de fourchette, qui a (re)pris le dessus.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Le déclin de cette tendance est la conséquence de ce qu’il y a de plus cynique. À mesure que les “petites assiettes à partager” colonisaient toutes les typologies possibles de restaurants, les portions dans les assiettes ont commencé à diminuer sans que leur prix, lui, ne change. Alors, forcément, les clients ont fini par s’agacer et à crier à l’arnaque. Si l’inflation est une réalité, si les produits et les matières premières de qualité ont un coût que l’on se doit de payer à leur juste prix, reste que certains établissements se sont montrés trop gourmands. Trop opportunistes.
Aujourd’hui, le constat est clair, et cette crise de confiance envers le monde de la restauration a fini par prendre des proportions dramatiques. Essayez d’en parler autour de vous, la conclusion sera unanime : les gens en ont marre.
Mais, un mal pour un bien, cette rébellion du consommateur a aussi fait naître une nouvelle dynamique : un retour à la tradition assez inattendu. Cette contre-révolution et la petite mort des “petites assiettes à partager” ont ouvert la voie à un nouvel âge d’or pour les brasseries, les bistrots, les bouillons et les tables aux menus plus lisibles, plus clairs. Réac’ ? Peut-être. Réappropriation de l’expérience à table ? Plutôt.
Et pourquoi, donc ? Certainement parce que dans une époque où le repli sur soi tend à devenir la norme, les gens ont besoin de retrouver des repères, un cadre, de la structure et du confort. Besoin, aussi, de se réfugier vers des choix simples, spontanés, presque primitifs.
Moins de chichis, plus de simplicité : des œufs-mayo, un bœuf bourguignon, une assiette de pâtes, une mousse au chocolat… Et un café, pour clôturer une parenthèse au restaurant qui n’aurait jamais dû se transformer en un tel casse-tête.
Cette révolution culinaire, née d’un vent de liberté sincère et de bonne foi, d’un affranchissement des codes éculés de la restauration, semble désormais révolue, ou, tout au moins, en pleine métamorphose et remise en question. Et c’est tant mieux.
Car dans le monde d’aujourd’hui, et de demain, on veut savoir ce que l’on mange, choisir ce que l’on mange… Et se faire surprendre, mais uniquement là où on l’aura nous-mêmes décidé.
Ce que les chefs pensent (vraiment) des “assiettes à partager”
Claire Grumellon (cheffe du restaurant Lissit à Paris)
L’idée du “restaurant à petites assiettes” est arrivée en masse, on ne sait pas trop ni d’où, ni comment. Mais en tant que cuisinière, j’ai trouvé l’idée vraiment intéressante. Ça nous a permis de s’affranchir, et de gagner en souplesse et de sortir un peu d’un cadre qui nous enfermait un peu.
Ce mouvement est aujourd’hui en train de s’épuiser, et je comprends pourquoi. Si l’on n’a pas envie de partager, pourquoi est-ce qu’on serait obligé de le faire ? Sur la “colère” vis-à-vis des prix, je suis obligée de parler de l’augmentation du coût-matière pour nous, restaurateurs. Les clients ont parfois du mal à entendre que c’est difficile pour nous aussi. Il y a effectivement des abus de la part de certains mais, en tant que cliente, quand je vais au resto, je me sens rarement flouée.
Si les additions sont “salées”, c’est parce qu’aller au restaurant devient malheureusement un luxe. Les petits restaurants qui essayent de faire les choses bien sont ceux qui s’en sortent le moins aujourd’hui. Chez Lissit, on a fait le choix d’orienter les clients vers le partage, de ne pas assassiner sur les prix, tout en essayant de s’en sortir correctement de notre côté, et j’ai le sentiment que nos clients s’y retrouvent. Mais c’est avant tout une question pratique (la cuisine fait 5m2 et je suis seule pour envoyer les assiettes, ce qui rend difficile un format entrée/plat/dessert) et une volonté de ma part (ça me laisse beaucoup de liberté et de créativité). L’important, c’est d’accompagner au mieux le client et lui laisser de la liberté, tout en lui expliquant les choix qu’on fait.
Anthony Salomon (chef du restaurant Le Dauphin à Paris)
On a vu émerger ces petites assiettes créatives avec des influences très variées (asiatiques, sud-américaines…). Une vraie mixité dans les assiettes, ce qui rend ce format très intéressant à travailler. C’est un format plus libre, plus fluide, plus direct, pour les cuisiniers. Et aussi plus simple d’un point de vue opérationnel pour envoyer des plats et fluidifier le service. Côté client, ça permet de goûter plein de choses, de partager, d’échanger autour des plats.
Mais le modèle de l’assiette à partager a été très (trop ?) utilisé. Et s’est un peu essoufflé. Certains clients ont pu se sentir lassés, voire floués : des prix parfois excessifs, des recettes pas toujours bien maîtrisées. On a une responsabilité en tant que restaurateurs : respecter la saisonnalité, la provenance, la qualité des produits. Cela passe par des cartes plus sobres, le goût, l’authenticité… plutôt que la surenchère créative.
Même si je comprends cette colère, il faut aussi prendre en compte le contexte que l’on subit. Le prix du poisson, de la viande, des légumes a considérablement augmenté. Cuisiner des produits de qualité a un coût. Mais certains ont abusé : sur les quantités, sur les prix, sur la promesse. Comme dans tous les métiers, il y a des dérives. Et forcément, ça entache la confiance des clients.
Il faut désormais revenir à une cuisine honnête, lisible, sincère. Le lien se reconstruit dans le temps, par la cohérence et la régularité. En s’appuyant sur des lieux qui durent, des maisons solides, qui ont traversé les modes. Au Dauphin, le menu se construit de manière instinctive, en fonction des produits que je reçois. La carte est structurée par type de produit : “poisson & coquillages”, “viande”, “végétarien”... Pas de format imposé. On fait beaucoup de conseil à table. Mais chacun peut, et doit, s’approprier l’expérience à sa manière
Leonardo Righini (chef du restaurant Le Chateaubriand à Paris)
Les restaurateurs ont sûrement répondu à une demande de rendre moins formels les repas au restaurant : plus convivial, plus différent. Pour certains lieux qui n’ont pas beaucoup d’espace, ou une cuisine pas très fournie, ça a permis de proposer une offre plus large. C’est un mouvement à double vitesse. D’un côté la saturation de cette offre, et de l’autre, un retour aux endroits plus traditionnels. Je ne pense pas que l’on observe un changement fondamental, mais plutôt que des restaurants plus classiques sont en train de retrouver une clientèle qu’ils avaient, peut-être, un peu perdu.
Il y a toujours eu des lieux avec des cartes compliquées, et d’autres plus simples. Mais “simple”, cela ne veut pas dire que ce n’est pas complexe. Se laisser aller entre les mains d’un menu “dégustation” devient ainsi un choix que l’on accepte sciemment. Je pense que les “petites assiettes à partager’” sont dans cet entre-deux, pas toujours identifiable. Tu te retrouves avec des petites assiettes avec un prix légèrement plus bas, voire égal à un plat d’une formule classique, mais où tu es censé en commander plusieurs pour pouvoir partager. Et donc, très vite, les prix grimpent.
Il faut donc miser sur son identité propre et marquée, en étant généreux dans son travail, et donc dans les assiettes, afin de recréer un lien. Là où je travaille, au Chateaubriand, on propose un menu “dégustation” en dix étapes, environ. Dans ce menu, il y a des séquences plus individuelles, d’autres plus conviviales. C’est la preuve que, tout en restant dans un menu personnel, on peut aussi offrir du partage.
Et la tendance des “petites assiettes à partager” à l’étranger, ça donne quoi ?
Victoire Loup (journaliste et autrice gastronomique installée en Californie)
📍 États-Unis
J’habite aux États-Unis depuis 2015, et avant cela j’avais passé quatre ans à Londres. J’ai vu le mouvement “family style” (les “petites assiettes à partager”) déferler sur les tables comme une traînée de poudre. Dans les pays anglo-saxons, ça m’étonnait moins car il n’y a jamais eu ce sacro-saint triptyque entrée-plat-dessert. En France, j’ai été surprise de voir que la mode des assiettes à partager prenne autant !
Aux États-Unis, cette tendance ne s’essouffle pas tant que ça. En Californie, le partage a toujours été dans l’ADN des restaurants. Ici, on commande “family style” ou “for the table” de manière assez naturelle. Le format tapas/mezze a été adopté très tôt, que ce soit dans des restos thaï, arméniens ou californiens. Mais ici aussi, aux États-Unis, on ressent une lassitude du partage à outrance, surtout quand il devient prétexte à des portions chiches ou à des prix dissimulés.
Les habitudes ne changent pas tant que ça, mais les clients ne se laissent plus berner. Ce besoin de lisibilité est très fort, comme une réaction au chaos ambiant. On a vécu des années de storytelling à outrance, de descriptions de plats interminables et cryptiques, où il fallait deviner ce qu’on allait manger.
Aujourd’hui, les clients veulent comprendre, et paradoxalement, cette lisibilité peut cohabiter avec le désir d’être surpris : à condition que ce soit un choix assumé par le client, comme dans les menus dégustation à l’aveugle, ou les tables d’auteurs très identifiées. Ce qui ne passe plus, c’est l’ambiguïté ou l’opacité. Dans une époque où le pouvoir d’achat est en tension, ce flou artistique devient une provocation.
Tommaso Melilli (chef du restaurant Trattoria della Gloria à Milan)
📍 Italie
J'ai commencé à travailler en cuisine à Paris il y a bientôt 15 ans et, effectivement, les "petites assiettes" n'existaient presque pas. Il y avait Le Dauphin, voilà, mais qui a toujours fait référence à une autre forme de la table, d’influence ibérique. Puis l'épidémie a commencé...
En Italie, la vague des petites assiettes est beaucoup plus récente. Surtout dans les grandes villes, pour l'instant. C'est un cancer. Ce qui est paradoxal, c’est que les influenceurs et la presse décrivent cette "tendance" comme le nouveau concept que tout le monde veut... Alors que j’ai l'impression que personne n’en veut vraiment, à part les restaurateurs qui les ouvrent. Et qui vont ensuite manger... dans les vrais restos.
J'ai ouvert mon resto à Milan avec l’idée d’un lieu sauvage, décontracté et décoiffé. Mais un restaurant, pas un bar à tapas. Avec des entrées, partageables, des plats, et des desserts. Je l'ai fait parce que c’est ce que j’aime et c’est ce que je veux manger. Et ça a très bien marché. Reste que depuis qu'on a ouvert, il n’y a peut-être que deux vrais restaurants, ici, qui ont ouvert sur ce modèle… Et en face, 20 bars à vin avec "petites assiettes". Franchement, je me sens très seul et je ne sais même plus où aller manger.
En soi, ce n’était pas forcément une mauvaise idée. Sauf que la petite assiette est presque devenue de l'orthodoxie. À chaque fois qu'on me parle de l'ouverture imminente d'un nouveau lieu, je pose des questions, et j'ai toujours peur du moment où je vais entendre : "Ah oui, en cuisine, on va faire des petites...". Et là, j'arrête d'écouter.
Le menu est un support textuel qui sert à raconter ce que l'on propose. J'en ai ras le bol des lieux où l'on s'assoit et le serveur arrive et demande : "Vous savez déjà comment ça fonctionne ?" Comment cela devrait fonctionner, nom de Dieu ? On regarde des noms de plats et on choisit... Tout ne peut pas devenir un concept. On essaie tous de lire et d'interpréter, chaque jour, un monde qui devient de plus en plus incompréhensible, les menus ne peuvent pas ressembler à une déclaration des revenus.
Si les “petites assiettes à partager“ semblent être vouées à disparaître, voici un plat, à vivre à plusieurs, qui survivra pour toujours à cette tendance.
De quoi parle-t-on ? Des cubes de tapioca du Dauphin, à Paris, pensés par l’immense chef Inaki Aizpitarte. Selon la légende, ils seraient un hommage à la recette des “dadinhos de tapioca” de Rodrigo Oliveira, à São Paulo, que le chef basque aurait ramenée dans ses valises, il y a une vingtaine d’années, après un voyage au Brésil.
Aujourd’hui, c’est le jeune et brillant chef Anthony Salomon qui continue de les faire briller à chaque service, du soir et du midi, toujours au Dauphin.
Si vous n’y avez jamais goûté, foncez-y. Vous y vivrez deux épiphanies : un amuse-gueule addictif qui ne vous lâchera jamais ensuite, et l’expérience de les avaler dans l’une des plus belles salles de restaurant de Paris.
Puisque le sujet du jour porte sur le retour en grâce de la restauration lisible et rassurante, laissez-moi vous dévoiler la brasserie où je me sens le mieux dans la capitale.
Un décor majestueux, des lustres, des nappes blanches, un service à l’ancienne, brusque et expéditif qui en fait tout le charme… Bienvenue chez Bofinger, brasserie alsacienne, historique et légendaire, du quartier de Bastille.
C’est l’endroit où j’amène mes amis lorsque je n’ai plus d’inspiration, là où j’embarque mes parents de passage à Paris, là où je viens parfois déjeuner en solitaire quand je passe dans le coin en vélo. Cette brasserie est, pour moi, l’expérience parisienne ultime, folklorique et “carte-postale”, mais aussi (et surtout) l’endroit le plus solennel, réconfortant, et un peu caricatural aussi, que Paris peut nous offrir.
Et pourtant, les scénaristes d’Emily in Paris n’y ont même pas pensé.
Le petit parasol en papier a longtemps été utilisé comme un ornement kitsch que l’on s’amusait à planter sur un cocktail ou un gâteau d’anniversaire dans les années 1990. S’il n’a jamais vraiment su s’imposer sur la durée – doublé par les bougies pyrotechniques qui font toujours leur petit effet –, il a toutefois su trouver son salut et peut désormais savourer sa petite renaissance à travers les mains d’une jeune génération de cuisiniers.
Ce petit parasol en papier, je l’ai d’abord aperçu au feu restaurant Goguette, planté sur son iconique “lotte-Chocapic”. Je l’ai vu, aussi, chez les chefs Zac Gannat ou Loïck Tonnoir, qui le glissaient, eux, sur un ris de veau surmonté d’anchois ou un bun de pied de cochon et piquillos. Et peut-être même, si je me souviens bien, chez Thomas Coupeau, à Pluto, ou Antonin Girard, à Pantobaguette.
À première vue, il pourrait apparaître comme une fantaisie, un gadget, un petit pas-de-côté narquois et insolent, mais ce petit parasol en papier est en réalité bien plus que ça. Coloré et désinvolte, il est devenu, malgré lui, l’un des symboles d’un mouvement et d’un courant gastronomique en pleine ébullition. Dans une époque qui a tendance à se prendre trop au sérieux, le parasol en papier s’impose alors comme l’étendard d’une rébellion et un pied-de-nez sarcastique, salvateur, pour une génération de cuisiniers affranchis, décomplexés, et enfin débarrassés des injonctions de la cuisine d’hier.
Dans In the Mood for Love, le film de Wong Kar-wai qu’on-ne-présente-plus, l’une des scènes emblématiques se plante dans le décor d’un steakhouse de Hong Kong. Un restaurant d’inspiration occidentale de la ville qui sert une cuisine fusion, appelée “soy sauce Western”, mêlant dans son menu des plats européens à des spécialités chinoises – et notamment cantonaises.
Dans cette scène, les deux protagonistes partagent un steak, accompagné de moutarde. Derrière son apparente banalité, cette séquence, lente et contemplative, offre en réalité une incroyable exploration des relations humaines, des sentiments cachés, dissimulés, et des non-dits sentimentaux. Ici, la nourriture œuvre comme une métaphore, une béquille, qui permet à Wong Kar-wai de questionner, comme personne, les émotions refoulées, les énergies silencieuses et les désirs inavoués.
Parce que, finalement, la bouffe n’est jamais vraiment que de la bouffe.
Aux États-Unis, les détenus condamnés à mort ont le droit à une “dernière volonté”. Avant leur exécution, ces derniers peuvent choisir leurs “derniers mots”, mais également leur “dernier repas”. C’est une réalité très familière pour les Américains, mais qui a tendance à fasciner les pays, comme la France, qui ont aboli la peine de mort.
De nombreux médias, chercheurs ou artistes, se sont penchés sur la philosophie de ces dernières volontés. Parmi les demandes les plus récurrentes : des plats simples et réconfortants (burgers, poulet frit…), mais pas que. Plusieurs travaux et recherches ont démontré que cette dernière opportunité de liberté pour les détenus était aussi le moyen d’asseoir des convictions (un menu végétarien), de revivre des souvenirs d’enfance (sundae aux Smarties, des biscuits et du lait…), ou d’accéder à l’inaccessible (un menu gastronomique digne d’un étoilé, par exemple).
La France est tellement le pays de la gastronomie qu’elle dispose d’une bibliothèque uniquement dédiée à l’archivage et à la collection de menus. Il y a quelques années, la bibliothèque de Dijon s’est effectivement vue confier la mission de numériser et sécuriser plus de 20 000 menus, datant de 1810 à nos jours.
On y retrouve des menus de repas officiels (banquets politiques, dîners diplomatiques…), des menus de restaurants et de palaces divers et variés, des menus de compagnies de transports (trains, paquebots, compagnies aériennes…), ou encore des menus privés, issus de réceptions de notables et de particuliers.
Et tout ça, vous pouvez l’explorer en ligne, juste ici.
Pour ceux qui souhaiteraient replonger, à nouveau, dans la magie simple et pragmatique des menus EPD (entrée, plat, dessert) à Paris, voici quelques suggestions de bistrots et restaurants, testés et validés, qui en honorent les codes. Liste non exhaustive, évidemment.
📍 Recoin (11e)
📍 Le Baratin (20e)
📍 Café Les Deux Gares (10e)
📍 Cuisine (9e)
📍 Les Arlots (10e)
📍 Parcelles (3e)
📍 Candide (10e)
📍 Racines (2e)
📍 Le Cadoret (19e)
📍 Café des Ministères (7e)
📍 Bistrot des Tournelles (4e)
📍 Café du Coin (11e)
📍 Auberge des Crus (16e)
📍 Café de l’Usine (11e)
📍 Le Collier de la Reine (10e)
📍 L’Orillon (11e)
Suivez ma carte Mapstr pour davantage d’adresses et recommandations de restos en tout genre. Elle est gratuite, encore plus complète, et mise à jour régulièrement.
Au détour d’une discussion avec la journaliste et chroniqueuse Philippine Darblay, j’ai appris qu’elle lançait à son tour sa propre newsletter, [Tribu]lations, où elle va explorer les coulisses de la création sous toutes ses formes. Une nouvelle aventure, une de plus, pour elle qui a déjà vécu mille vies entre Paris, Copenhague, Londres ou Stockholm.
Aussi, puisque son quotidien est (en grande partie) animé par la recherche incessante de petites adresses où l’on mange bien, je lui ai soutiré quelques-uns de ses lieux fétiches, ou repérés récemment, où l’on honore, comme il se doit, le format de l’entrée + plat + dessert.
📍 Sauvage (6e). “Pour ses asperges à l’oseille en entrée, et rognons de lapin en plat (pas pris de dessert).”
📍 La Ferme du Pré (16e). “Pour son nouveau menu printanier : velouté de petits pois et condiments, raie aux câpres (pas pris de dessert, non plus.”
📍 Auberge Bressane (7e). “Pour sa mini terrasse et ses morilles farcies à la volaille en entrée, soufflé au comté en plat, et soufflé caramel beurre salé en dessert.”
Si je peux vous donner un petit conseil : abonnez-vous sans attendre à sa newsletter, [Tribu]lations, qui vous offrira un aperçu de sa vie de journaliste culinaire et art de vivre, entre tendances, astuces, observations, coulisses de la création (mode, beauté, bien être, cuisine…) et portraits de créatifs qui font bouger les choses.
Un peu de ciné, un bistrot, Belmondo dans le rôle d’un flic aux méthodes douteuses… Et un steak-frites qui débouche sur une gigantesque baston de bar.
Voici ce que je vous propose pour clôturer ce numéro.
C’est tout pour aujourd’hui. Merci de m’avoir lu. On se retrouve, ici-même, dans un petit mois. D’ici là, portez-vous bien !
→ Mon Instagram où je montre ce que je mange.
→ Ma carte Mapstr où je dévoile là où je mange.
→ Mon Instagram (secret) où je fais de la peinture.
→ Mon (autre) identité où j’infiltre des supermarchés.
→ Mon Tumblr qui prouve que je suis un vieux d’Internet.
Vous recevez ce mail car vous êtes abonné à la newsletter “Entrée, plat, dessert”.
Cet email vous a été transféré ? Abonnez-vous ici



























