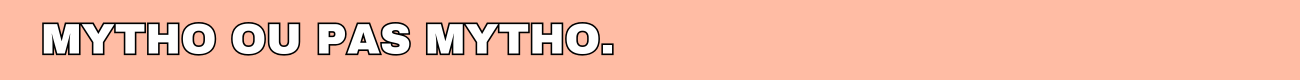Les chefs ont-ils un problème avec leurs couteaux ?
Les chefs sont très attachés à leurs couteaux. Mais avant d'utiliser des lames de qualité, ils ont longtemps trimballé leurs couteaux usés de l'école de cuisine... Jetés à la poubelle ou conservés précieusement, que sont-ils devenus depuis ? J'ai mené l'enquête.
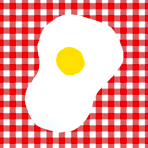
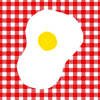
Un peintre ne prêtera jamais ses pinceaux.
Un musicien ne prêtera jamais sa guitare.
En cuisine, un chef ne prêtera jamais ses couteaux.
Depuis toujours, les cuisiniers entretiennent un lien puissant et intime avec leurs lames. Bien plus qu’un simple outil du quotidien et prolongement symbolique de leur main, les couteaux absorbent une histoire, des souvenirs, et aussi un paquet de traumatismes.
Car un couteau est plein de paradoxes : il accompagne les longs services, il aide, il sauve, il dépanne, il rassure… mais il coupe et il blesse, aussi. Le genre d’ustensile que l’on chérit autant qu’on aime le détester, avec un attachement étrange, à la limite du fétichisme et de la superstition.
Dans les cuisines de restaurants, de l’apprenti au chef toqué, on les cache, un peu partout, dès lors qu’on a le dos tourné. Pour ne pas se les faire chiper durant les jours de repos, ou pour éviter que quelqu’un nous les abîme. On les cache, comme on planque son doudou à la maternelle ou son mug préféré dans l’open-space.
Chacun le sien, et pas touche.
Pour décortiquer ce rapport affectif et obsessionnel des cuisiniers à leurs couteaux et comprendre pourquoi ces lames les hantent et les habitent, je suis allé poser quelques questions à des chefs et cheffes d’horizons très différents, du palace au restaurant de quartier.
Pour cette newsletter, ils ont accepté de rembobiner leurs souvenirs et de se livrer à un petit exercice d’introspection, pour révéler ce qu’il est advenu de leur mallette et de leurs vieux couteaux de jeunesse – ceux de l’école de cuisine et de leurs premiers jobs en cuisine. Abandonnés, mis de côté, ou conservés précieusement comme des reliques du passé ?
Vous allez tout savoir.
Les chefs ont-ils gardé (ou balancé) leurs vieux couteaux de l’école de cuisine ?
💬 Pierre Touitou (chef du restaurant 19 Saint-Roch à Paris)
J’ai gardé avec moi la mallette de mon apprentissage — le contenant, pas le contenu — et j’ai conservé trois couteaux, dont deux sont encore en circulation au restaurant. Ces couteaux sont en “libre-service”, mais pour des tâches bien précises : le grand éminceur (Le Jeune ©) de ma mallette pour tailler les blancs d’œuf cuits de notre île flottante. Un petit éminceur acheté 15€ chez Dehillerin en 2009 (qui m’a servi à "casser" des quantités astronomiques de homard) qui est utilisé par tout le monde, pour toutes sortes de tâches. Et quelque part, dans notre petit labo en sous-sol, se trouve encore un filet de sole. J’ai aussi la même aiguille à brider depuis mon apprentissage.
J’aime beaucoup la patine que les objets prennent avec le temps : cela peut aller d’un Zippo à une paire de bottes, en passant par le col d’une chemise. Ce qui est formidable avec les couteaux, c’est qu’ils deviennent de plus en plus petits à force d’affûtages. Les tâches pour lesquelles on les choisit évoluent avec le temps, et j’aime beaucoup les petites marques qui se créent et se développent, comme des preuves du temps qui passe. J’ai tendance à garder les choses longtemps, tant qu’elles me sont utiles. Parfois même des habits devenus trop petits… avec l’espoir qu’ils m’iront à nouveau un jour.
💬 Marine Gora (cheffe des restaurants Gramme à Paris)
Non, je n’ai quasiment rien gardé de mes débuts, à part peut-être un petit couteau d’office ou un filet de sole gravé avec mes initiales. Le CAP, c’est un peu comme une rentrée scolaire : on te donne une liste de matériel à acheter, une mallette avec des couteaux standard. Je me souviens : mon tout premier couteau avait une lame interminable… Avec le temps, j’ai appris à choisir les outils qui me convenaient vraiment. Je n’ai jamais eu de lien sentimental avec ces premiers couteaux. Une fois mon CAP en poche, j’ai surtout cherché à me construire ma propre identité, y compris dans mes outils. Je ne suis pas du genre à trimballer dix couteaux : en général, j’en utilise deux, mais ils doivent être efficaces, polyvalents, et me ressembler.
💬 François Roche (chef du restaurant Prosper à Marseille)
J’ai gardé quelques vieux couteaux. Pas tous, parce qu’avec le temps, on investit dans des couteaux plus adaptés à notre pratique [voir photo ci-dessous]. Mais il y en a certains que je n’ai jamais pu me résoudre à jeter ou à oublier au fond d’un tiroir. C’est des outils qui ont traversé le temps avec moi, à l’école, dans mes premiers restos… Pas les plus “tendance”, mais ceux avec lesquels j’ai appris, fait mes premiers gestes, et mes premières erreurs aussi. Aujourd’hui, il y en a que j’utilise encore à la maison. Et au resto, j’en mets certains à disposition des apprentis qui n’ont parfois pas encore de matos. Je trouve ça plus utile que de les laisser dormir au fond d’un casier.
💬 Ella Aflalo (cheffe indépendante)
Oui ! J’ai retrouvé premiers couteaux d’école, de 2012, il y a quelques années, lors d’un déménagement. Ils étaient dans une mallette fermée à double tour. Évidemment, impossible de retrouver le code… Alors, j’ai dû sortir la pince… Et là, le Graal ! Une collection de couteaux chromés, du manche à la lame. Je les garde dans mon placard et je les utilise tous les jours à la maison : ils sont magiques, et je n’ai presque jamais besoin de les aiguiser. C’est très curieux ! Ils sont importants car ils me ramènent à mes premiers rêves et espoirs de cuisine. J’ai taillé mes premières brunoises avec, je me suis coupée… Ils ont ce goût des débuts que je ne veux pas effacer. Et en même temps, ils me font sourire : ils n’ont rien de professionnel, ils sont lourds, pas faciles à manier… mais il m’est difficile de m’en séparer.
💬 Amaury Bouhours (chef du restaurant étoilé Le Meurice à Paris)
J’ai toujours mes premiers couteaux, ceux que j’ai achetés quand j’ai commencé au Louis-XV à Monaco — un éminceur Misono et un trancheur GCK. Je les garde dans un tiroir, dans les cuisines du Meurice, et je m’en sers tous les jours. C’est des outils auxquels je suis très attaché, pas seulement pour leur qualité, mais aussi parce qu’ils font partie de mes habitudes de travail. J’ai beau avoir d’autres couteaux plus récents, je ne retrouve pas les mêmes sensations avec. Je les connais par cœur, ils sont presque une prolongation de ma main. Et puis je les ai achetés avec mon tout premier salaire, donc forcément, il y a une valeur sentimentale particulière [il rit].
💬 Sven Chartier (chef du restaurant Oiseau Oiseau à Préaux-du-Perche)
Je n’ai pas gardé les couteaux que tu reçois quand tu débutes à l’école. Ils n’étaient ni de très bonne qualité, ni très beaux. Mais j’ai toutefois gardé un couteau de mon premier job, à L’Arpège. Un éminceur Global qu’ils m’avaient acheté après qu’Alain Passard me casse le mien. Je ne m’en sers plus, car je le trouve trop rigide, mais il est toujours devant moi, sur le mur de ma cuisine, car il porte le souvenir d’une expérience très formatrice.
Dans ma famille, il n’y a ni reliques, ni trésor, ni aucun objet d’une valeur suffisamment élevée pour venir saborder un héritage. Alors, oui, j’ai bien quelques ancêtres lointains, en Italie, qui ont fait l’acquisition de peintures hors de prix – du Raphaël, du Caravage, du Velázquez, du Bacon –, exposées à Rome dans la Galerie Doria-Pamphilj (oui, comme mon nom, Panfili…), mais il semblerait qu’ils aient oublié de m’inclure dans la succession.
Ça tombe bien, je m’en fiche.
Je ne prête que très peu d’attention aux choses qui brillent et qui coûtent cher. Je porte mes Vans jusqu’à ce qu’elles soient trouées. J’ai le même porte-feuille en cuir depuis 10 ans, et un smartphone (pas un iPhone) qui rame. Je ne voyage presque jamais en Première Classe dans le TGV, et j’ai appris il y a seulement deux semaines que Bottega Veneta n’était pas le nom d’une boîte de nuit, mais celui d’une marque de luxe.
À l’inverse, j’accorde beaucoup d’importance à des choses qui peuvent sembler futiles, absurdes ou anodines : un ticket de métro en carton d’une ville que je viens de visiter, un échantillon de savon d’hôtel dont je ne me servirai jamais, un petit caillou ramassé lors d’une randonnée, ou un sachet de mayo ramené d’un fast-food à l’autre bout du monde.
Au milieu de ces obsessions mi-étranges / mi-névrosées, il y a un aussi couteau que je conserve très précieusement, depuis quelques semaines.
Un couteau de table, fait-main, récupéré chez ma grand-mère. Une pièce rare qu’elle tient de son bien-aimé et défunt compagnon de vie, Claude, fabriqué par un drôle de personnage. Un coutelier, hirsute et ronchon, qui bosse depuis toujours dans l’obscurité d’un minuscule atelier-boutique (“Napoléon”), juste à côté du café du centre-ville où mes parents nous amenaient, mon frère et moi, chaque dimanche matin, lorsqu’on était petits.
Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi ce couteau m’obsède.
Peut-être simplement parce qu’un objet n’a rien d’unique, de spécial ou de singulier, jusqu’à ce que l’on décide de projeter en lui notre âme, notre cœur et des sentiments incontrôlables.
Et quand j’y repense, ce n’est pas la première fois que je m’émeus pour un objet contondant. Avant celui-ci, il y a eu les autres : mon couteau-suisse rouge de quand j’étais gamin, l’Opinel pour cueillir les champignons que m’a offert mon papa, les grands couteaux noirs aiguisés de ma maman dans le tiroir de la cuisine.
Comme quoi, parfois, des lames, qui tranchent et qui rassurent, valent autant qu’un gros carton à souvenirs ou qu’un diapo photo de vacances que personne ne regarde jusqu’à la fin.
Le saviez-vous ? La véritable tradition du kebab exige que la broche de viande soit taillée au couteau… et non avec une trancheuse électrique, comme on le voit un peu partout.
C’est une règle d’or qui s’est malheureusement perdue au fil des années. Il reste toutefois encore quelques rares lieux qui perpétuent ce rituel. Parmi eux, Özlem, le meilleur döner de la capitale, où son patron, Edip Bolatoglu, continue de manier la lame avec rigueur et poésie.
Un jour, on a embarqué le chef Yotam Ottolenghi là-bas, juste après un tournage dans la boutique d’épices Roellinger pour Konbini. On a avalé un sandwich, discuté autour d’un ayran et, à la fin du repas, on a plaisanté en lui proposant de s’essayer à la taille de la broche. Edip, le patron, a dit “oui”, et on a vécu un petit moment suspendu.
Quelques semaines plus tard, lors d’un autre tournage chez Özlem, j’ai demandé à Edip, le patron, si je pouvais essayer de tailler la broche au couteau, moi aussi. Il m’a dit “oui”, mais m’a surtout mis en garde : “Tu me fais pas de bêtises, hein”. C’était juste avant le début du service, et la pression de ruiner la broche, avec un geste gauche et maladroit dont j’ai le secret, était trop forte.
Alors je me suis abstenu. Mais j’y retournerai bientôt, et je la trancherai cette broche.
Offrir un couteau en cadeau, ça porte (vraiment) malheur ?
Selon une obscure légende urbaine, il serait d’usage, et fortement recommandé, de donner une pièce de monnaie en échange à quiconque s’aventurerait à vous offrir un couteau. En général, je ne crois pas vraiment à ces histoires, et pourtant, je me plie à ce rituel à chaque fois.
Alors j’ai cherché à comprendre d’où venait cette drôle de superstition.
Après quelques recherches, j’ai appris que l’on cultive cette croyance autant en France qu’en Espagne, en Italie, en Grèce, en Amérique latine ou en Scandinavie. Partout, elle répond à la même logique : offrir un couteau sans contrepartie symbolique serait susceptible de porter la poisse, de briser une amitié, un amour ou les liens entre la personne qui offre et celle qui reçoit.
Dans certaines traditions religieuses ou païennes, les objets tranchants renfermaient une forte puissance rituelle (la protection, oui, mais aussi le danger). On évitait donc de les offrir sans précaution. La petite pièce de monnaie matérialiserait donc une transaction, aussi minime soit-elle, transformant le cadeau en achat symbolique. Cela ”brisait” ainsi la malédiction, rendant l’échange équilibré et réduisant le risque qu’un couteau puisse anéantir une belle histoire.
Morale : c’est sûrement des bêtises, mais cela ne coûte pas grand-chose, surtout si ça permet de soigner son karma et de ne pas se porter l’œil. Franchement, dans le monde dans lequel on vit, c’est un luxe à peu de frais dont il serait bête de se priver.
Ce petit cheval en argent, aperçu au Trou Gascon (Paris), ne serait-il pas la plus belle chose qui puisse accompagner une paire de couverts dans un restaurant ?
À moins que ce soit… ce couteau à beurre nacré, datant de l’Exposition universelle de 1900, posé sur la table de Plénitude, le restaurant triplement étoilé du chef Arnaud Donckele, au Cheval Blanc (Paris) ?
Retour à mon interrogatoire de chefs, fil rouge de cette newsletter.
Au-delà des lames de leurs jeunesse qu’ils ont conservées, ou pas : quels sont aujourd’hui leurs couteaux fétiches, à la valeur sentimentale inestimable ?
💬 Marine Gora (cheffe des restaurants Gramme à Paris)
J’ai acheté l’an dernier deux couteaux sur un marché au Vietnam. Ce jour-là, je me suis coupée sur l’étal en le manipulant, mais j’ai fait la fière devant la vendeuse en cachant ma blessure… Dans ma cuisine, à la maison, ils décorent, car c’est du bricolage (la lame est imbriquée dans le manchon en bois). Mais j’adore la courbe et la gravure. J’aime ramener des petits ustensiles et couteaux de tous mes voyages, même si je suis toujours en stress que ça ne passe pas à la douane…
💬 Pierre Touitou (chef du restaurant 19 Saint-Roch à Paris)
Enfant, j’avais vu le Japon avec mes parents. Plus tard, j’y suis retourné, autrement. J’ai acheté trois couteaux que j’ai utilisés pendant 6 ou 7 ans. Lors de mon dernier voyage là-bas (où j’ai évidemment acheté plusieurs couteaux et beaucoup de matériel), j’ai ramené ces mêmes couteaux chez l’artisan pour un entretien et un affûtage. Ils étaient assez surpris de les revoir, d’ailleurs ! Ils sont "à la retraite" maintenant. Je m’en sers encore de temps en temps, mais je les réserve pour des occasions particulières.
💬 François Roche (chef du restaurant Prosper à Marseille)
J’ai énormément de couteaux de poche : pour les champignons, pour les huîtres, des Opinel en pagaille… Mais j’ai surtout, toujours sur moi, mon couteau suisse, qui m’est cher et précieux, Il m’est autant utile pour un pique-nique que pour du bricolage de dernière minute, quand il t’arrive un pépin au resto. C’est un objet incroyable et très polyvalent. Je m’en sers tout le temps et je le lâche jamais.
💬 Amaury Bouhours (chef du restaurant étoilé Le Meurice à Paris)
Quand je voyage, j’adore rapporter un couteau avec moi. C’est un peu mon achat compulsif et en même temps un souvenir. Le façonnage d’un couteau, c’est un vrai art, un savoir-faire propre à chaque pays, avec des spécificités différentes. Je trouve que c’est fascinant.
Les Japonais sont très doués en matière de lames et de couteaux. On l’ignore parfois, mais ils sont aussi très fortiches en pizza, ce qui a tendance à rendre fous les pizzaiolos italiens. Pas étonnant, donc, qu’ils soient également très inspirés lorsqu’il s’agit d’imaginer des roulettes à pizza d’exception.
Voici donc une roulette à pizza, fabriquée par le forgeron Shizu Hamono, installé à Seki, une ville japonaise rendue célèbre pour son savoir-faire et sa production de lames depuis plus de 750 ans.
Une lame en pur acier inoxydable, manche en Keyaki (orme du Japon), et une prouesse artisanale qui a un prix : 55 euros.
Oui, tout de même.
Vous vous souvenez du confinement ?
On se faisait chier, on picolait en visio et on écrivait des mots (à la main) pour s’autoriser nous-mêmes à aller faire les courses ou juste prendre l’air.
Pendant qu’on écumait les séries, qu’on avalait des bouquins ou qu’on scrollait Twitter comme des zinzins, d’autres se sont montrés plus malins et productifs. Par exemple, le photographe-prodige Julien Mignot et son ami d’enfance Vincent Lappartient ont eu une idée qu’on aurait tous aimé trouver. Puisque les chefs, habituellement si occupés, ont du temps libre, pourquoi ne pas les solliciter pour un projet photo inédit ?
Voilà comment ils ont eu l’idée d’immortaliser des cuisiniers en compagnie de leur couteau fétiche, dans un splendide livre, Tranchants. Une centaine de chefs et cuisiniers, dix boulangers-pâtissiers, six bouchers, six sommeliers, trois journalistes, deux forgerons, deux confiturières, un pizzaïolo et un chocolatier plus tard, le livre est né. 132 lames, en noir et blanc, racontant autant d’histoires et de trajectoires, d’Alain Passard à Alain Ducasse en passant par Adeline Grattard.
Et pendant ce temps, nous, on relançait The Office pour une troisième fois.
Dans The Truman Show (1998), Truman Burbank, incarné par Jim Carrey, vit dans un monde entièrement factice. Si de nombreuses séquences ont marqué les esprits et l’histoire du cinéma, une scène se démarque et implique… un couteau. Une scène en apparence anodine où sa femme Meryl vante et encense une poudre de cacao de manière stéréotypée, à la manière d’un spot publicitaire – en réalité, à destination des téléspectateurs qui suivent le programme.
Pourquoi cette scène est-elle si importante ? Car Meryl, forcée par la production de l’émission, s’y colle avec un sourire figé, un ton artificiel, un peu trop mis en scène. Ce qui éveille les premiers soupçons chez Truman qui vient à s’interroger sur ce comportement qui semble faux et suspect. Puis parce que c’est à ce moment du film qu’il commence à entrevoir la supercherie qui l’entoure, et où Meryl, se sentant en danger, finit par brandir une batterie de couteaux pour se protéger.
Flashback : fermez les yeux et imaginez-vous à l’époque de l’ORTF. Un temps où l’on se faisait laver le cerveau, certes, mais où l’on ne se posait pas la question de savoir si Cyril Hanouna allait bien pouvoir venir déloger la légende Alain Chapel, occupé à cuisiner un “arrière de lapin de cabane aux herbes”, sur un plateau de télévision, toque vissée sur le crâne.
C’est tout pour aujourd’hui. Merci de m’avoir lu et pour vos gentils messages. Cette newsletter est totalement indépendante, libre, et fabriquée avec le cœur, alors merci d’y prêter un œil et autant d’attention. On se retrouve, ici-même, dans un petit mois. D’ici là, portez-vous bien !
→ Mon Instagram où je montre ce que je mange.
→ Ma carte Mapstr où je dévoile là où je mange.
→ Mon Instagram (secret) où je fais de la peinture.
→ Mon (autre) identité où j’infiltre des supermarchés.
→ Mon Tumblr qui prouve que je suis un vieux d’Internet.
Vous recevez ce mail car vous êtes abonné à la newsletter “Entrée, plat, dessert”.
Cet email vous a été transféré ? Abonnez-vous ici